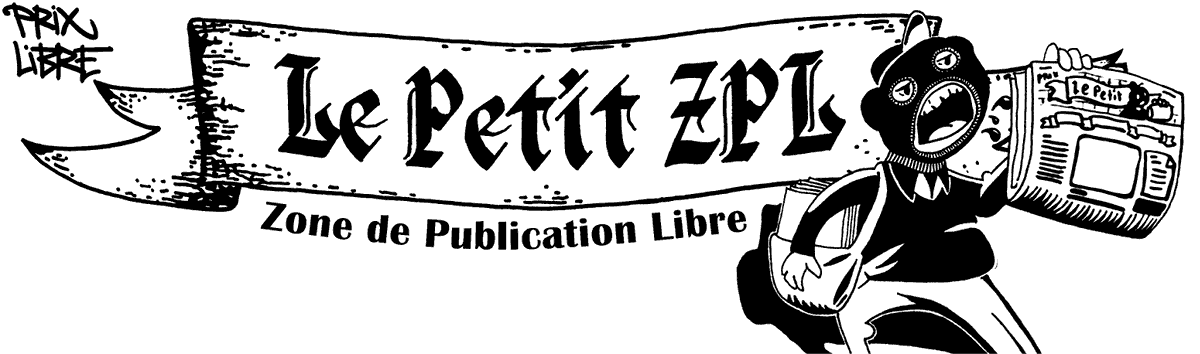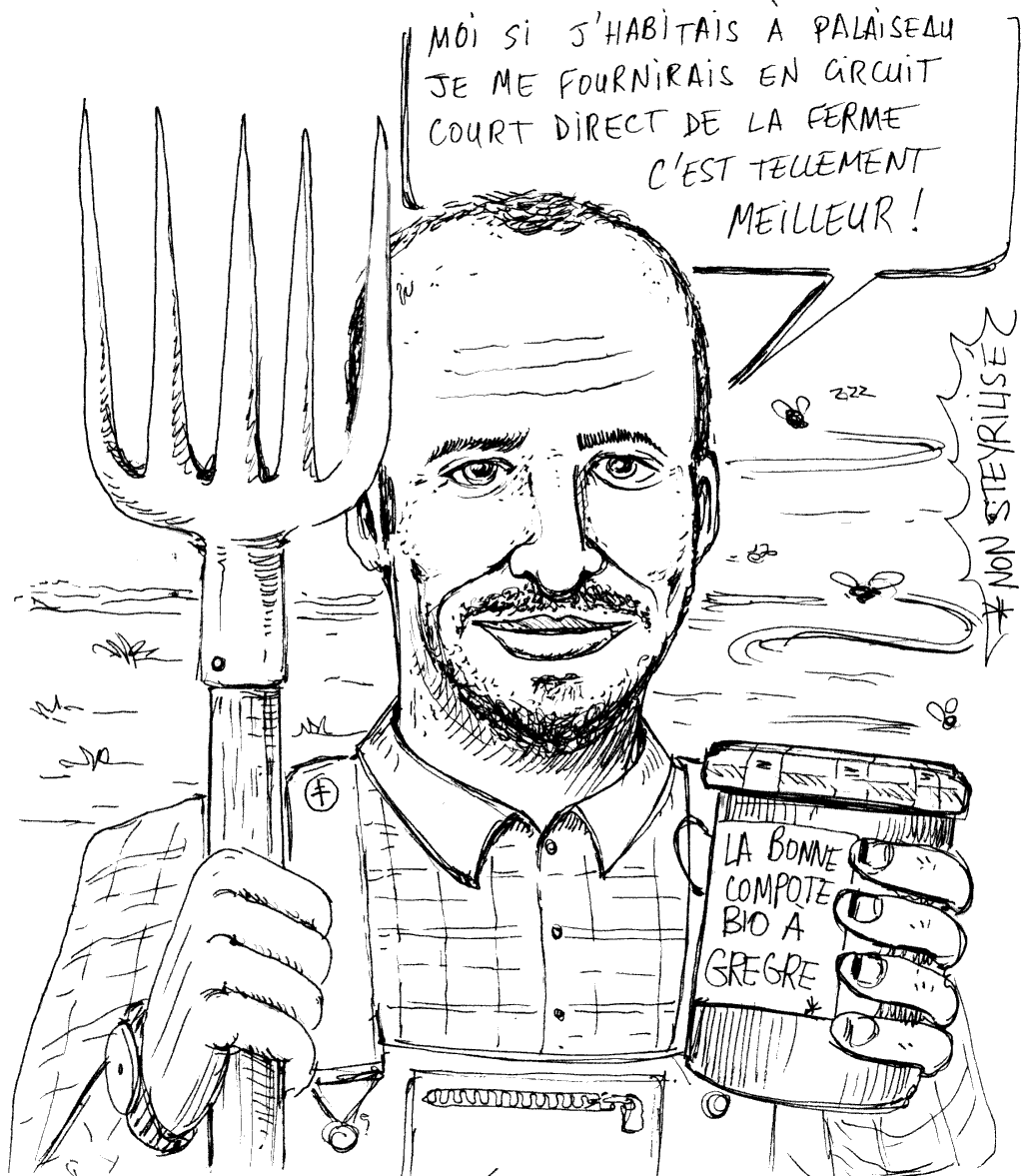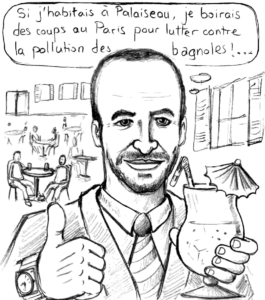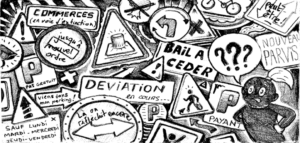En premier lieu, précisons que la ferme ne représente qu’un bout d’un plus vaste projet. Sur cette parcelle de plus de 17 hectares (jusqu’à récemment cultivée par M. Laureau, ferme de la Martinière), sept hectares iront à l’INRA pour ses expérimentations, en compensation des 66 perdus suite à l’aménagement du secteur du Moulon(1). Six hectares sont mis à la disposition de la Société du Grand Paris (SGP) qui a l’obligation de remplacer le bois de Polytechnique, rasé pour la construction du centre de maintenance de la ligne 18. Des arbres y seront plantés et les terres définitivement perdues pour l’agriculture.
Construire une ferme et encore bétonner ?
Afin de réaliser cette opération, il a fallu réviser le Plan local d’urbanisme pour changer le zonage (la vocation de la parcelle). C’est-à-dire passer la parcelle d’espace naturel de loisirs (NL) en naturelle à vocation agricole (NA). Comme le prévoit la loi, une enquête publique a eu lieu(2). Parmi les onze observations déposées, plusieurs remarques portent sur l’augmentation de l’emprise au sol autorisée par ce nouveau zonage. En gros, il est désormais permis de construire sur 30 % de la parcelle contre 10 % avant. Or, cela ne se justifie pas au regard des trois projets : une micro-ferme, un boisement et un terrain expérimental. Pas au top, la protection des terres.
Ensuite, aucune réunion publique n’a été proposée à la population qui a été informée du projet par le magazine municipal (juillet 2023), mais pas de l’enquête publique. Dans le rapport du commissaire enquêteur, les six associations participantes estiment ne pas avoir été assez associées au projet. Elles notent également que ni les associations locales expertes (comme Triangle Vert ou Terre et Cité) ni les élu⋅es de la minorité n’ont été consulté⋅e⋅s. En revanche, une étude de faisabilité a été confiée, pour 110 000 euros, à un bureau d’études « Cultures et Compagnie », dont les dirigeant⋅es sont, sans surprise, diplômé⋅es d’écoles de management ou de commerce. Rien à voir avec le métier de la terre. Bon, pour la caution technique, un maraîcher a quand même été associé à l’étude.
La ferme à papa : des objectifs à la pelle
Sur les quatre hectares dédiés à la ferme une foultitude d’objectifs sont avancés par la com’ municipale(3). Ainsi, il s’agit tout à la fois d’« affirmer les valeurs écologiques et de nature en ville », « de préserver la biodiversité », « proposer un projet pédagogique intergénérationnel et inclusif », mais aussi de « favoriser l’installation d’exploitants agricoles » et même de « renforcer la résilience alimentaire de la commune ». Pour M. Rimbert, trésorier des Jardins de Cocagne de l’Abbaye de Limon « nous n’avons pas candidaté car les objectifs étaient trop nombreux pour un seul projet ». Anthony, un des participants au webinaire de présentation, s’inquiète lui-aussi d’un projet « qui paraît difficile pour une personne seule ».
Production, pédagogie et résilience
Côté production, l’objectif de « vente directe, fournir les cantines scolaires ainsi que les professionnels du secteur (restaurants, épiceries, artisans, fleuristes) »(4) est-il réaliste ? D’abord, la répartition des surfaces entre les deux lauréats(5) n’est à ce jour pas communiquée(6). On ne connaît pas non plus la répartition des surfaces entre safran, fleurs coupées et légumes.
Interrogé sur la capacité de production de la ferme des Marnières, M. Rimbert répond « je dirais, au doigt mouillé, car ne connaissant pas la répartition de surface entre les deux porteurs de projet, le jardin pédagogique et les bâtiments, un potentiel maximum de 150 à 200 paniers/semaine en pleine saison ». Ce que nous confirme Tenneguy Pichon, chargé de développement agricole et partenarial au Groupement des agriculteurs bio d’Île-de-France : « en maraîchage bio classique, sur un hectare, on peut produire un panier hebdomadaire pour environ 50 familles, mais tout dépend de ce que l’on veut produire ». La production maraîchère restera donc anecdotique à l’échelle de la ville surtout si la production de « safran [occupe] une place prépondérante »(7). Pour approvisionner les cantines scolaires, un axe fort de la com’ officielle(8), on repassera.
Ainsi, ce projet censé « renforcer la résilience alimentaire »(9) de la commune ne touchera qu’une infime partie de la population. Selon différentes sources, le renforcement de la résilience alimentaire nécessite « un ensemble cohérent d’actions à mettre en œuvre »(10). C’est une démarche globale qui comprend notamment l’installation d’agriculteurices, la diversification des variétés, l’autonomie en semences, l’économie d’énergie et d’eau mais également la préservation des terres agricoles. Pour Palaiseau, le diagnostic alimentaire de « crater »(11), un outil développé par l’association Les greniers d’abondance, est sans équivoque : surface agricole par habitant trop faible, objectif de préservation des terres(12) non atteint sur la période 2013-2018 et enfin dépendance très marquée aux pesticides. Aux Marnières, le projet de ferme n’est pas le résultat d’une réflexion sur le devenir de l’agriculture sur l’ensemble de l’agglo dont le maire de Palaiseau est par ailleurs président.
De plus, la construction de bâtiments et parkings est prévue sur environ 5000 m2. Autrement dit, c’est un demi-hectare de plus perdu pour l’agriculture. D’autres sites ont-ils été envisagés pour installer ces bâtiments ? A priori, non, selon la synthèse du Commissaire enquêteur. Au Petit ZPL, on se dit que ça aurait été une belle idée pour sauver la Ferme des Granges mais on n’a pas été consulté.
Ainsi, sur le plateau de Saclay qui, depuis 2016 et l’opération Blanc-Sarkozy, a déjà payé un lourd tribut au béton(13), chaque hectare compte. Or, le bilan des projets sur cette parcelle de 17 hectares laisse dubitative. Sept sont perdus pour le boisement, un demi pour des bâtiments à quoi s’ajoute la possibilité de construire plus.
L’approche municipale ressemble donc bien plus à une opération de com’ d’un maire bétonneur(14) qu’à une politique volontariste pour la résilience alimentaire, qui exige une approche globale sur le territoire et sur le long terme. Soit bien plus que la création d’une micro-ferme toute bio et pédago qu’elle soit.
Sabrina Belbachir
- (1) En 2012, l’INRA disposait de 90 ha de terres expérimentales et à certaines périodes, jusqu’à 96. Aujourd’hui, cette surface a été rabotée à 24 ha.
- (2) Du 12 juin au 12 juillet 2023
- (3) L’énoncé de ces objectifs diverge selon le public ciblé : la population ou financeurs potentiels. Dans cet article, nous traitons les objectifs tels que présentés dans la fiche d’intention « Leader » – programme de financement européen géré localement – soumise par la municipalité pour le financement des bâtiments de la ferme
- (4) Pal’Mag de juillet 2023, p.14
- (5) Idem
- (6) Contactées par la rédac, Mme Person, élue à la transition écologique, et la chargée de projet au même objet n’ont pas répondu à nos questions.
- (7) Voir Infolettre de Cépal, octobre 2023
- (8) Voir ville-palaiseau.fr
- (9) Ce concept désigne la capacité d’un territoire à garantir la sécurité alimentaire de ses habitants, dans un contexte de perturbations multiples et imprévisibles.
- (10) Greniers d’abondance, dans sa synthèse « Pour une résilience alimentaire »
- (11) crater.resiliencealimentaire.org
- (12) Dans le jargon, on appelle ça le ZAN soit Zéro Artificialisation Nette, c’est un dispositif national censé protéger les sols du béton.
- (13) Environ 250 hectares rien que sur la commune de Palaiseau.
- (14) Grand défenseur du campus Paris-Saclay et de la ligne 18 (dont la partie Ouest), Lasteyrie siège à l’Établissement d’aménagement du plateau dont il adoube les projets. Il prévoit par ailleurs un nouveau quartier au niveau de la Croix de Villebois (OAP-Plateau dans le PLU)